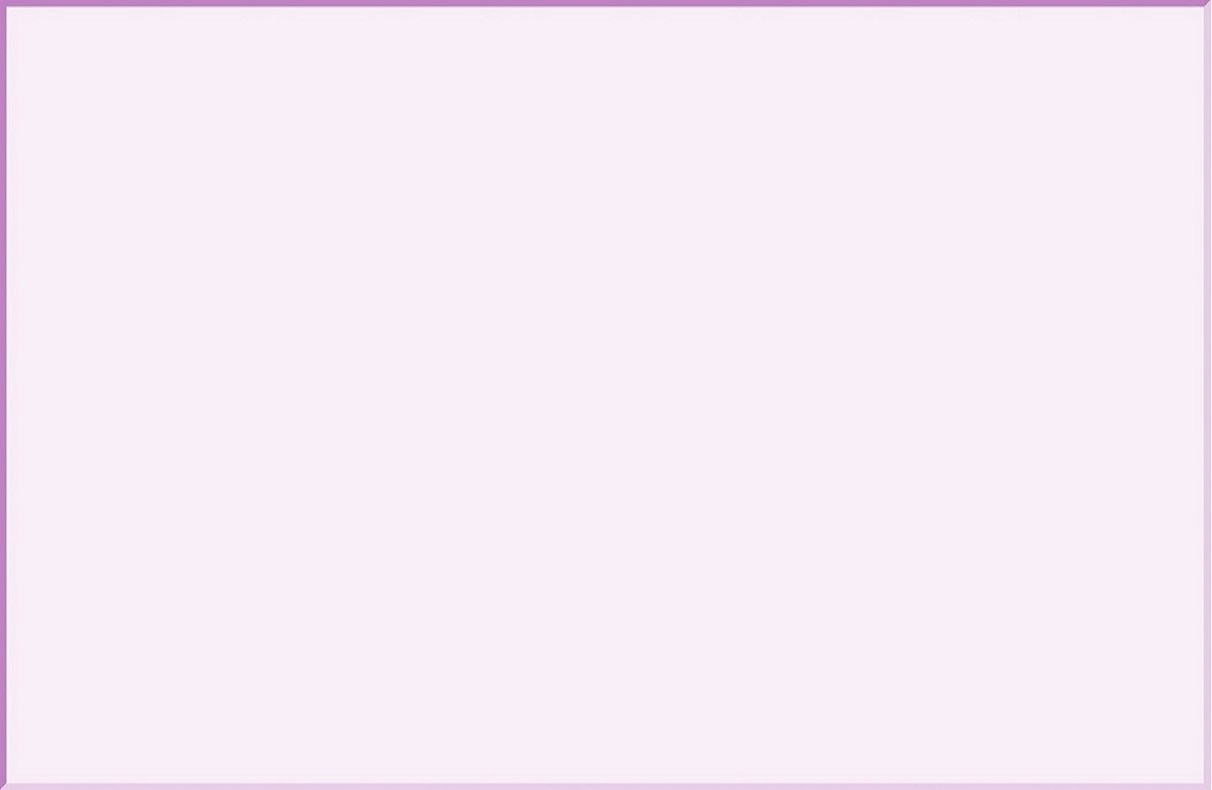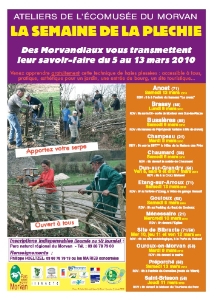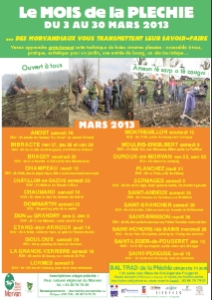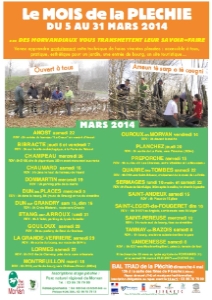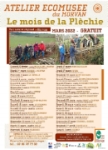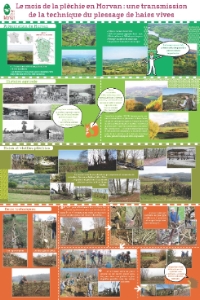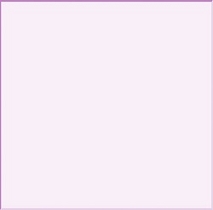


| La plèchie |
|
Plessie ou plèchieC’est la même chose,
mais « plèchie » c’est du patois !
DéfinitionC’est une haie vive
formée avec des tiges ou des branchettes (brandies) d'arbres entrelacées.
« Dans quelques parties du
Morvan, les « plèchies » parsemées de hêtres séculaires que la cognée a forcé
de courir dans tous les sens comme d'énormes serpents offrent au regard
d'admirables monstruosités végétales. »
« Chacun doibt ung jour pour
faire Plessez autour son château. » OrigineL’origine de la plèchie
remonte probablement à la nuit des temps.
Les chasseurs-cueilleurs se sont converti à
l’agriculture et à l’élevage il y a fort longtemps, au cours de cette longue
préhistoire.
Tout comme aujourd’hui, les premières clôtures étaient destinées autant à parquer le bétail qu’à protéger les maigres cultures. Suivant les lieux et surtout selon ce dont on
disposait, il s’agissait de haies de pierres ou de haies sèches (ou haies
mortes) faites de branchages diversement assemblés et tressés. Avec ces dernières, le problème était, outre la moindre résistance au temps, la grosse consommation de bois dont on avait également besoin ailleurs, pour le feu notamment. On ne sait qui en eut l’idée ni quand exactement, mais les haies vives sont apparues. Dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules » (De
Bello Gallico -58 à –51), Jules César rappelle que les « Nerviens », peuple
gaulois du Nord-Est de la Gaule, utilisaient des haies défensives, des «
Saepes » (du latin saepio : cloturer).
« … les Nerviens, n’ayant qu’une cavalerie sans valeur…, avaient depuis longtemps recours, afin de faire obstacle à la cavalerie de leurs voisins, dans le cas où ils viendraient faire des razzias chez eux, au procédé suivant : ils taillaient et courbaient de jeunes arbres ; ceux-ci poussaient en largeur de nombreuses branches ; des ronces et des buissons épineux croissaient dans les intervalles si bien que ces haies, semblables à des murs, leur offraient une protection que le regard même ne pouvait violer… » Si ce n’étaient pas des plèchies, il faut bien convenir que cela y ressemblait terriblement ! Dans son « Glossaire du Morvan (1878), Eugène de Chambure nous révèle que des traces écrites remonteraient au moins au 11ème siècle. : « Pleissa se montre dès le
XIème siècle dans la basse-latinité .
En bas latin, plessiare,
plessare, joignait le sens de coucher une branche à celui de plier. Tous les
patois ont un terme pour exprimer l'idée du « plessage » des bois.
L'action de fléchir, de
coucher, d'entrelacer les branches d'arbres pour clôture a donné naissance à
un assez grand nombre de mots dont les formes variables, suivant les
dialectes, se sont conservées dans les noms propres et dans les noms de
lieu.
Les familles appelées Plessis
ou Plessier sont très nombreuses et il n'y a peut-être pas de contrée où l’on
ne trouve des châteaux, des maisons de campagne, des bois, des prairies,
etc., nommées le Plessis, le Plessier, etc.
Dans la Nièvre seulement je
trouve quatorze localités, ainsi désignées.
L'une d'elles, « les
Plessiers », dans la commune de Lucenay-les-Aix, est appelée en 1231 Xemus de
Plexum seu Plassiacum.
Une autre, « le Plessis »
près de Nevers, est en 1293 Domus dou Plasseiz ;
Plessiacum en 1331.
« Le Plessis », lieu détruit
entre Moulins-Engilbert et Châtillon, était écrit en 1311 Plasseium, en 1322
Plaisseyum.
On peut consulter sur ce mot
Ducange à Plassetum, Plaxetum, Plecticium, Pleisseicium, Plesseium,
Plessiacum, Plexicium.
Les variétés plessa, pleissa,
plesses, se montrent fréquemment dans les manuscrits du XIIème siècle.». Plus près de nous, nous trouvons « des traces de
pléchies » dans les écrits d’Alfred Guillaume (l’Ame du Morvan) :
Ein tor de force... et de béte (Un tour de force… et
de bête) :
- « lai vaiche qu'étot de
trébin lai pus forte, le mâtrîyot ; maugré lu, ille le poussot dans lai
pléchie. » (la vache qui était de loin la plus forte, le dominait ; Malgré lui elle le poussait dans la haie.) - « N. de D... de veille gairce ! Te voués bin que la vaiche me fout tôt le temps dans lai pléchie ! » (N de D… de vieille garce ! Tu vois bien que la vache me fout tout le temps dans la haie ! ») La fête au village :
- « Tenez… Quoué que c’ot que
c’t’ouyais de pléchie ?… Vous le connaissez-ti vous-z-autes ?… Quoi qu’à vint
feurber por d’iqui ?… » (Tenez… Qu’est-ce que c’est que cet oiseau de haie ?… Vous le connaissez-vous autres ?… Qu’est qu’il vient chaparder par ici ?…) Étymologies et différence entre brosse et pléssieEugène de Chambure
(toujours lui), nous apprend également que :
(Accès direct au Glossaire d'Eugène de Chambure sur ce
site : ICI) « Beaucoup de mots qui ont été français et à ce titre usités pour la désignation d'un champ, d'un pré, d'un bois, sont depuis longtemps sortis de la langue usuelle ou y ont pris une acception détournée qui les défigure, mais ils se sont maintenus, plus ou moins intacts, dans les campagnes avec leur sens primitif On les retrouvera donc là
comme des contemporains toujours prêts à déposer en faveur de la véritable
origine. »
Pour sa démonstration, il utilise 3 mots dont « chaume » qui n’est pas particulièrement utile ici mais que je laisse en hommage à l’auteur : « Prenons pour exemple les trois mots « brosse, plessie, chaume », si fréquemment inscrits sur nos registres cadastraux. Brosse : Chez nous c’est la haie vive
qui forme la clôture des héritages. Elle arrête le bétail parqué dans les
pâturages. La relation entre cette brosse et l'instrument garni de crins avec
lequel on nettoie les vêtements saute aux yeux de l'observateur.
En effet la haie sans cesse
broutée par les animaux présente au regard une série de pointes végétales qui
rend parfaitement compte de la métaphore. D'un autre côté les allures
vagabondes du troupeau errant le long de ces clôtures vivantes peuvent
expliquer aisément le verbe brosser qui, dans l'ancienne langue, signifiait
rôder dans les halliers, dans les buissons, et qui dans le langage
particulier des chasseurs sert encore à indiquer une course à travers bois.
L'anglais to brush, dérivé du
primitif brush, brosse d'habit et broussaille, s'emploie également dans le
sens de raser, de passer rapidement. L'adjectif brushy, hérissé, répond à
l'idée de chose pointue qui est dans l'étymologie du mot.
Plessie : De brosse à plessie la
transition est facile puisque ces termes sont absolument synonymes, indiquant
tous deux le même objet considéré dans un état différent. La haie livrée à
elle-même, c'est-à-dire munie de tout son appareil végétal de tiges et de
pousses, est la brosse proprement dite; elle devient une plessie (plèchie en
patois) lorsque les brins un peu forts ont été à demi fendus avec la serpe
ou la cognée de manière à pouvoir se courber, se coucher horizontalement.
Par extension les deux mots ont été usités l'un pour l'autre et ont servi
concurremment à désigner toutes les haies vives de la contrée qu'elles
enguirlandent si gracieusement.
Il y avait des « plesseurs »
comme aujourd'hui encore dans le Morvan. Ces ouvriers
étaient chargés du soin des clôtures vives. Quant au verbe plesser,
tiré directement du latin « plectere », il a disparu comme le
substantif, son dérivé. Il n'en reste que le terme d'anatomie «
plexus ».
Chaume : Passons au mot chaume qui ne
nous est pas moins familier et qui n'existe plus en français sous sa forme
féminine et avec la signification que nous lui donnons.
Dans notre région une chaume
est un terrain gazonné, ordinairement de mauvaise qualité. Une lande, un
pâquis communal. Les anciennes coutumes font souvent mention de ces
chaumes-là.
Sous le nom de
Hautes-Chaumes, et avec une fertilité beaucoup plus grande, elles forment le
couronnement verdoyant des ballons vosgiens.
Dans le Jura les Chaumes sont
des montagnes à pâturages. L'idée de gazonnement s'attache si bien au vocable
que nous en avons tiré un verbe « chaumer, achaumer », qui renferme
exactement le sens de gazonner. Une terre « achaumie » est une terre où
l'herbe a poussé plus ou moins drue. En français le chaume est tout autre
chose. C'est ou l'éteule qui demeure dans le champ après la moisson, ou
la paille de seigle que nous appelons « glui » et dont on se sert pour la
couverture des toits dits de chaume. » Rectification d’une étymologie erronéeEugène de Chambure ne
laisse rien passer et a le coup de plume acéré.
La pléchie c'est sérieux, ce n'est pas fait pour
embellir ! « Monsieur L. Delisle définit un plessis dans son étude sur les Classes agricoles en Normandie, (p. 346) : « Une portion de bois ou
forêt fermée par une clôture de bois vif dont les branches s'entrelaçaient.
»
Cette exacte définition met à
néant l'erreur de Ménage, de Puretière et de la plupart des lexicographes qui
expliquaient la dénomination de Plessis ou Plessier en disant que le lieu
avait été ainsi nommé à cause des bois qui servent d'ornement et
d'embellissement aux maisons.
Camden dans sa description de
la Bretagne est parti de ces fausses notions pour dériver ridiculement
plessis de placere, plaire, et non de plexus, plectere, plier, entrelacer,
qui a donné au français le terme d'anatomie plexus, entrelacement de
diverses branches de nerfs. »
Il a également quelques doutes quant-aux compétences des prétendus spécialistes… « Voilà donc trois mots (brosse, plèchie et chaume) essentiels à l'étude des cartes topographiques, trois mots qui manquent à nos dictionnaires et qui seraient à jamais perdus si les patois ne les avaient pas recueillis avec beaucoup d'autres de même nature. Ainsi on peut affirmer que la confection d'une légende territoriale de la France, à la fois exacte et complète, demeurera impossible tant qu'on n'aura pas pénétré au fond des idiomes provinciaux. Quoi qu'il en soit de tous ces aperçus sur les services que les patois pourraient rendre à la philologie, il n'en est pas moins vrai qu'à leur source même ils ne sont guère en faveur. L'auteur d'un travail quelconque sur le parler rustique de son pays se trouve le plus souvent aux prises avec cette interpellation un peu moqueuse : A quoi sert le patois, pourquoi tant de labeur pour un si mince objet ? Répondre avec Charles Nodier que les patois sont faits pour nous dédommager du bon français qui se fabrique aujourd'hui serait peine perdue. Nous ne le voudrions pas croire tant nous aimons la petite littérature de notre journal. Si on mettait en avant l'opinion des savants autorisés qui se sont constitués les champions de ces études, on obtiendrait moins de crédit encore. » Quelques motsPlèchie , plécha,
plècher , pléïon, pleier, plesser… nous feraient penser à Rosa rosa rosam,
Rosae rosae rosa, Rosae rosae rosas, Rosarum rosis rosis…
J’espère qu’il ne vous feront pas penser à «
prechi-prêcha ».
Fouesser : Inciser au pied, coucher et entrelacer
Fléchir : Eugène de Chambure précise : « Il est surprenant que notre langue n'ait pas d'expression pour définir l'action de coucher le bois vif Fléchir est un terme général qui ne dit rien de particulier à l'esprit. Le vieux français avait les deux formes plesser et plessier qui se trouvent encore dans Ménage et dans les dictionnaires de l'époque. Furetière ne donne que le substantif « plessis » qu'il dit être un vieux mot désignant une maison de plaisance. Antérieurement, Palsgrave, (p. 448), écrivait : Je fléchis ou je Plessie. « On peult flechyr ou
Plessier une gaulle nouvellement cueillie, etc. ».
Le trouvère Benoit emploie souvent les verbes plaisser, plaissier, au sens propre de courber, plier. Il dit d'un prince
orgueilleux, (v. 208) :
« Ceo dit l'estoire e li
escriz
Qu'il ne se deigna une
baissier
Ne vers nul rei sun col
Plaissier. »
Pléchâ : Tige ou branche d'arbre qui a été couchée vive pour
la clôture d'un héritage.
Les « plèchie s « se composent d'une série de «
pléchas »
« Pléchâ » désigne une chose
courbe comme le sont les douves d'un tonneau :
Duas magnas tinas vinarias
bonas et pulchras cuni Plechis... Cupa Plechata... Un tonneau Plechat. »
Plècher ou plesser : Plesser, coucher des tiges, des branches d'arbre au
moyen de la serpe ou de la cognée pour former des clôtures.
Courber, ployer les tiges d'arbres pour clore
les héritages.
Plesser est la forme officielle employée dans
les actes de notaires.
« Toutes les haies vives du Morvan sont régulièrement « plèchées » ou " plessées » de manière à ce que les ouvertures se trouvent fermées au fur et à mesure que le temps détruit le bois mort ». « L'erbe qui croist en la rivière Se Plesse, puis revient
arrière.
(Rutebeuf, Vie Sainte
Elysabet.) »
Pleier : Plier, ployer, fléchir, courber.
Le patois morvandiau ne fait pas la distinction des sens différents des verbes plier et ployer. Et Eugène de Chambure qui nous aura largement accompagné au cours de cette page nous rappelle que la distinction faite entre ces deux mots est tout à fait arbitraire « puisque les deux verbes ont la même origine et ne sont autre chose que deux formes dialectales du même mot. Nous disons « pléier » un jonc et « pléïer » du linge. On parlait de même au IXème siècle : Por manatce, regiel ne
preiement,
Niule cose non la pouret
omqui Pleier.
(Chant de Sainte Eulalie.) »
Pleïon : Ou pleyon, petite perche généralement flexible dont on
se sert pour conduire le bétail aux champs (ne pas confondre avec l’aigûllon
du galvacher qui était généralement fait avec du houx et dont l’extrémité
était terminée par une pointe de fer).
Par extension, bâton, gourdin :
Un playon de charrue...
« Le suppliant trouva que on avoit osté ung baston appellé Ployon duquel on fait tourner le coultre de la charrue... » pôs : Pieux
Queule : Arbre ayant poussé en gardant la forme initiale qui
lui avait été donnée dans la plèchie
Mise en œuvreContrairement à
certaines idées reçues, il est tout à fait possible de plècher 2 fois dans
l’année : en hiver et au mois d’août, quand la sève est arrêtée, même «
feuillé », le bois ne meure pas.
Tout le bois qui est dans la haie doit vivre.
Les plesseurs commencent par enlever tout ce qui n’est
pas adapté à la haie : sureau et frêne trop vaillants, bois mort ou trop âgé,
ronces, lianes et autres broussailles.
Les autres essences sont conservées, les épineux (prunellier, aubépine…) le sont pour leur action défensive. Les tiges solides (chêne, acacia, châtaigner…) sont
soit conservées en place pour servir de pieux ou coupées pour être réutilisées
au même usage suivant le besoin.
Ces pieux sont coupés en biseau et les bords retaillés
afin de limiter au maximum les infiltrations d’eau sous l’écorce et éviter
ainsi le pourrissement.
Les pleïons seront eux entaillés à la base de manière
à être couchés (généralement dans le même sens) tout en laissant passer la
sève, et entrelacés dans les pieux.
Ils peuvent ensuite être attachés avec des « rouettes
» (liens fait avec de fines branches tournées sur
elles-même pour les assouplir)
Pour des raisons évidentes de garde du bétail et pour bien séparer les animaux pouvant se trouver de chaque côté de la haie, les plèchie entourant les prairies étaient généralement plus larges que les celles situés autour des champs labourés. Le pléchage pouvait, héhas très rarement, être appliqué aux chemins qui devenaient alors de véritables arches végetales. Les arbres fruitiers se trouvant dans la haie étaient
conservés.
En une journée, entre 8h30 et 17h00, et en se réservant bien sur une heure pour le casse croûte, deux plécheurs pouvaient réaliser une centaine de mètres. Une fois plèchée, la haie ne demandait plus qu'un entretien et pouvait attendre une bonne décennie avant d'être à nouveau pléchée. Plèchie ou barbelé ?Le barbelé (de l'ancien
français « barbele » qui désignait des objets hérissés de pointes) était à
l’origine, un fil et une pièce en bois munie de pointes.
Son utilité était bien sur d’empêcher le passage du bétail mais surtout, aux USA, lors de la fameuse conquête de l’Ouest, il servait à limiter le passage des grands éleveurs et cow-boys, défenseurs de la « libre pâture » que rien ne devait arrêter. C’était bien sur aussi un moyen comme un autre pour
repousser les Indiens…
En 1865, le Français Louis Jannin inventa ce qui devait devenir le barbelé après qu’il eut été largement amélioré en 1874 par l’américain Joseph Glidden qui construisit également la première machine capable de le produire en grande quantité. Ce barbelé, aussi appelé « fil de ronce », fut massivement utilisé lors de la guerre de 14-18. A la fin de la guerre, il fut enlevé des champs de bataille, roulé en botte et revendu aux agriculteurs via les coopératives. Gros handicap : il était cher et le morvandiau pas
très riche. Et il cassait les habitudes…
La plèchie de son côté avait tout bon : elle était hermétique, elle permettait de récupérer tout (ou presque) d’un bois qui faisait défaut pour le chauffage et dont les petits morceaux, la charbonnette, servaient à raviver le feu (Les premières bouteilles de gaz ne seraient arrivées dans le Morvan que dans les années 1950, jusque là, la cuisinière à bois était incontournable...).
Dans les haies il y avait du lièvre et du lapin, les
oiseaux y faisaient leurs nids et elles servaient de brise-vent pour le
bétail.
Et surtout, le bétail ne risquait pas les blessures
(par la suite, certaines vaches ont perdu le trayon –extrémité du pis- dans
les barbelés) Le remembrementLe principe était de
regrouper les parcelles trop petites ou trop dispersées afin de les rendre
plus facilement exploitables en réduisant notamment les temps de déplacement
des agriculteurs.
Par la suite, la topographie et l’évolution des
matériels furent prises en compte, ce qui contribua à l’amélioration des
conditions d’exploitation mais permit aussi d’adapter la voirie locale.
Les premiers exemples de remembrements remonteraient au Moyen Âge et auraient eut pour but de regrouper les biens de certaines abbayes. L’histoire ne dit pas si c’était pour aider les paysans et augmenter la production ou juste pour avoir tout leur domaine autour d’elles. Le premier véritable remembrement eut lieu en 1707 à Rouvres-en-Plaine (21), une commune bourguignonne située à une douzaine de kilomètres au Sud-Est de Dijon. Il conduisit à diviser pratiquement par 10 le nombre de parcelles tout en conservant la surface de chaque propriétaire. Cette pratique se développa faiblement par la suite. Durant le 19ème siècle, le Bassin parisien adopta le
système, puis le 20ème siècle vit s’instaurer quelques lois en conséquence.
La première n’eut pas d’effet. La deuxième, en 1941,
était déjà essoufflée dès sa parution.
Ce n’est qu’en 1960 puis surtout en 1980, mécanisation
oblige, que le remembrement prit toute sa signification.
Depuis, 15 millions d’hectares auraient été remembrés.
Mais il y a un revers à la médaille. Ce phénomène s’est accompagné de la suppression de
quelques 750 000 km de haies de toutes natures mais hélas de haies vives
principalement. Et moins les terrains étaient accidentés plus le remembrement
s’est développé et plus les haies ont été arrachées.
Et ce n’est pas tout, les chemins, les fossés, les
talus, les cours d’eau, les mares, les zones humides ont payé le tribut au
progrès. Il fallut assécher, drainer, niveler, et modifier les chemins pour
aligner les parcelles.
Si l’impact écologique fut longtemps minimisé, il est aujourd’hui indéniable. Les dommages collatéraux se traduisent par des inondations, des nécessités de drainage (ou d’arrosage…), des glissements de terrains, une érosion des sols… Ajoutés à des choix de cultures largement modifiés depuis 50 ans, la potion est redoutable. Dans ces conditions, il est clair que la plèchie qui commençait à être sérieusement abandonnée l’a été quasi définitivement au profil du fil barbelé, tellement plus facile à mettre en œuvre lorsque tout est à refaire… La plèchie aujourd’huiLes petites parcelles
acquises par les paysans morvandiaux ont été plèchées jusqu’aux années 1950.
La plèchie s’est véritablement arrêtée vers 1960.
Dés lors, les haies ont été taillées, entretenues au « voulant » ou au « goujard », mais plus jamais plèchées. C’est l’époque où la mécanisation commençait à remettre en cause les méthodes de travail, tout commençait à être différent, il y avait déjà plus à faire en moins de temps. La notion de temps devenait différente. Enfin, les éleveurs n'ayant plus le temps d’entretenir les haies et encore moins de les refaire, la « ronce artificielle » et le girobroyeur (ou l’épareuse) sont devenus beaucoup plus rentables. Aujourd’hui, la technique de la plèchie n’est déjà plus qu’un vague souvenir pour la plupart d’entre-nous. Le Mois de la PléchieEn 2009, le Parc
Naturel Régional du Morvan (PNRM) soucieux de la préservation d’un tel
savoir, organise "La semaine de la plèchie" qui deviendra
rapidement le "mois" de la plèchie, permettant ainsi à
quelques « anciens » et à quelques plus jeunes, de transmettre et
d’acquérir cette technique, de se rassembler en divers lieux et de
procéder à des démonstrations grandeur nature.
Cette sensibilisation, fort louable, mobilise et
attire de nombreux plècheurs avertis ou « néo plècheurs » novices dans une
ambiance à la fois studieuse, festive et détendue. Effectivement, au-delà du côté festif et démonstratif,
le mois de la pléchie est bien une transmission de savoir-faire. Sur certains sites, il y a de 1 à 5 stagiaires, sans compter les lycées agricoles et forestiers... En 10 ans, ce sont quelques 850 stagiaires qui ont été formés. Après une journée, ces stagiaires ont compris la technique et savent inciser et plesser. Reste l’œil et la maitrise... à perfectionner chez eux... Toujours est-il qu’il y a quand-même un hic ! Et même plusieurs… Tout d’abord, la devise de ces journées est : « Ameun
tè sarp o tè cougni » (Amène ta serpe et ta cognée). C’est bien ! Seulement voilà ! On entend bien trop le bruit de la tronçonneuse… et les plècheurs (et spectateurs) ont plutôt tendance à suivre « l’homme à la tronçonneuse… ». Il la manie fort bien mais, là encore, la tradition paie son tribut au progrès. Ensuite, le plèchage s’accompagnant naturellement de nombreux branchages qu’il faut éliminer, on se retrouve devant un redoutable dilemme : - On brûle ? Mais en ai-je toujours le droit ? En
cette période ? A cet endroit ? Ai-je le temps de rester pour m’occuper du
feu ? (Encore cette notion de temps).
- On récupère ? Oui pour les gros morceaux, avec la
tronçonneuse c’est vite fait. Mais le reste ?
Les outilsPas la tronçonneuse…
Sarp ou Sarpe : Serpe, instrument de forme courbe qui sert à couper, à
tailler le bois.
« Il n'y a pas de maison morvandelle qui n'ait sa «
sarpe » et sa « coingnie »
Cougni ou Coingnie : Cognée, espèce de hache à marteau dont se servent les
bûcherons.
La cognée a été une arme de combat
La forme « kugni » que l’on retrouve parfois ne figure
pas dans le « Chambure ».
Goujard, Goyar, volant (parfois volan), vouge croissant : En vieux français on nommait goye ou goyart, une
serpe, une houlette de berger, une faucille et, en général, tous les
instruments à forme courbe.
La forme « vouve » que l’on retrouve parfois ne figure
pas dans le « Chambure ».
Il existe également des serpes et des vouges à fer droit
Sans oublier le principal : la meule et la pierre à
aiguiser car tous ces outils étaient là pour un travail bien
précis, pas pour décorer.
« Sa Sarpe et sa coingnie
prist
Dont aguisic avoit ses piex.
»
[Renart, v. 16424.)
HéritagesVous avez pu lire à
plusieurs reprises plus haut, que la plèchie était « la clôture des héritage
».
Exact !
Et faute d’un métrage précis tel que l’on peut le
concevoir aujourd’hui, il paraitraît que les anciens, petits malins qu’ils
étaient, avaient une certaine tendance à plècher vers « l’extérieur », « sur
le chemin », ce qui permettait d’agrandir tranquillement sa propriété,
son «héritage».
Il paraît qu’ainsi, en une dizaine d’année, un chemin
pouvait « disparaître ».
C'est peut-être encore une « coutume » qui s’est perdue mais il y a indiscutablement une bonne part de folklore là dedans... Si j'ai bien tout suivi, les haies n'étaient pléchèes à nouveau que tous les 10-15 ans... Ça ne colle pas. Quelques autres photos des journées de pléchieVoici quelques photos
prises au cours des années de sensibilisation à la pléchie.
|