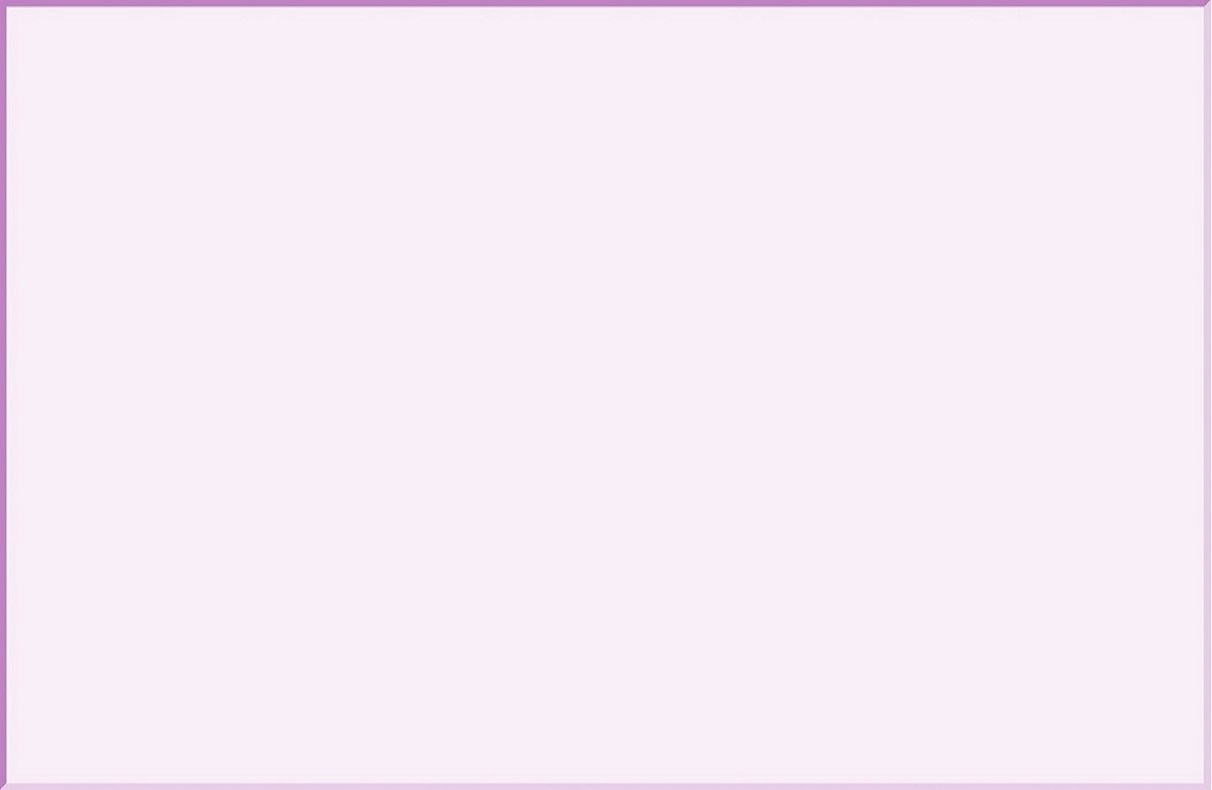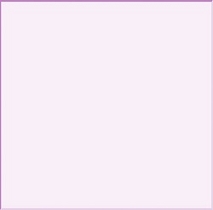


| Coutumes et croyances |
|
... et
superstitions Une définition ?Wikipédia nous donne
les définitions suivantes des 3 mots :
- La coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un territoire déterminé ». La coutume est une des sources du droit.
- La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère dogmatiquement à une thèse ou des hypothèses, de façon qu’elle les considère comme vérité absolue
- Le terme superstition vient du latin « superstitio » et en français a eu plusieurs sens : Il signifiait au XIVe siècle « religion des idolâtres, culte des faux dieux » ; au XVIIIe siècle,
il désignait la religion et les préjugés inexplicables par opposition à la
raison.
Quant-à lui, Diderot expliquait dans son encyclopédie : « Il n'y a aucun fait qui ne
soit précédé et qui ne soit accompagné de quelques phénomènes. Quelques
fugitifs, momentanés et
subtils que soient ces phénomènes, les hommes doués d'une grande
sensibilité, que tout frappe, à qui rien n'échappe, en sont affectés, mais
souvent dans un moment où ils n'y attachent aucune
importance. Ils reçoivent une foule de ces impressions. La mémoire du phénomène
passe ; mais celle de l'impression se
réveillera dans l'occasion ; alors ils prononcent que tel événement aura lieu
; il leur semble que c'est une voix secrète qui
parle au fond de leur cœur, et qui les avertit... C'est une multitude
d'atomes imperceptibles chacun, mais qui,
réunis, forment un poids considérable qui nous incline, sans presque savoir
pourquoi. » Quelles origines ?Difficile de savoir où
fini l’un et où commence l’autre (ou inversement…)
César a dit, « La nation gauloise, est tout à fait sous l'empire des superstitions. » Dans les archives de la Société Eduenne, une « note sur les pratiques superstitieuses observées dans le Morvan » rapporte : « Les immenses régions que couvraient les forêts étaient habitées par des hôtes plus redoutables que les loups et les ours. Les terribles divinités de la Gaule y résidaient, wivre's, dragons aux formes monstrueuses, nains hideux, fées et spectres hantaient leur profondeur. Les plus braves ne pouvaient
y pénétrer sans effroi. Le prêtre lui-même en avait peur Ces esprits
élémentaires se mêlaient à tous les actes de la vie domestique. Visiteurs nocturnes du foyer,
ils veillaient sur le berceau de l'enfant et sur les sépultures de la famille.
Ils avaient leur demeure, les uns aux sources des
fontaines et des fleuves, les autres au sommet des montagnes, sur la cime des
rochers aux formes sauvages et dans les plus
sombres cavernes. D'autres enfin se cachaient dans les vieux chênes et dans le
feuillage de hêtres.
Parfois, ils se montraient
dans, la brume, aux carrefours des bois, sous des formes et dans des
circonstances étranges. Les lieux consacrés par
ces apparitions étaient des lieux maudits et dont on n'approchait qu'avec
effroi. Ce qu'il y avait de particulier chez ce
peuple, c'était sa prédilection pour le culte des
divinités inférieures dont les fonctions étaient délimitées et avec lesquelles
il se croyait en communication c'était cette
multitude d'esprits, qui personnifiait à ses yeux les forces élémentaires de la
nature… » En résumé, il semblerait que les Celtes aient apporté
leurs cultes des éléments (soleil, tonnerre, vents, montagnes, lacs, forêts,
sources, fleuves, feu…), les Romains leur savoir et leur organisation, le
Christianisme l'amour et la liberté, les Francs toutes leurs manières barbares
et que bien d’autres y aient saupoudré d’innombrables choses…
Ce savant mélange a pu conduire à des choses étranges. Avec la christianisation, les démons étaient chassés
des villes par les saints, aussi les retrouvaient-on dans le fin fond des
campagnes, aux carrefours, près des arbres chargés de
trophées de chasse ou d'ex-voto, près de lieux réservés autour des fontaines où
l’on se livrait, paraît-il, « à quelques ébats licencieux… ».
Toutefois, les propriétaires chrétiens du sol,
n’osaient s’y opposer de peur de soulever quelques nombreux fidèles. Quoi qu’il en soit, le Morvan et les morvandiaux, semblent avoir gardé une forte prédominance des traditions celtes. Le culte du feuInutile de revenir trop
en détail (sauf à vouloir faire exploser ce site…) sur ce que le feu a pu
apporter à l’homme depuis qu’il l’a
découvert puis maîtrisé.
Mais au fait comment l’a-t-il découvert ? Dans la mythologie grecque, Prométhée (celui qui
réfléchie avant…), Titan sans père et fils de Thétis (encore qu’il serait,
aussi, paraît-il le fils du Titan Japet et de l'Océanide Clyméné), se rebelle
contre Zeus et lui dérobe « le feu divin » pour le donner aux mortels.
Zeus fort mécontent, enchaîna Prométhée à un rocher
des montagnes du Caucase, et là, chaque jour un aigle venait lui dévorer le
foie, un foie qui repoussait chaque nuit, pour une douleur éternelle.
Est-ce pour cela que toutes les peuplades de la terre ont voué au feu un véritable culte ? Le feu a toujours été un symbole de purification. Dans nos campagnes, depuis la nuit des temps, on «
brûle » la terre pour la rendre plus fertile, par extension, l’utilisation du
bûcher pour certaines condamnations rejoint cette purification.
Cette purification se retrouvait aussi sur les chemins de cimetières où l’on avait coutume de brûler la paille du lit sur lequel le défunt avait rendu l’âme. Représentation du soleil bienfaiteur, le feu est devenu tout à la fois et plus que tout, coutume, croyance et superstition : Allumer le feu, utiliser ses pouvoirs, craindre qu’il ne s’éteigne… Très rapidement, l’homme se servit du feu pour marquer les grandes dates qui règlent sa vie, en commençant par le passage des saisons. Toutefois, les traditions étaient fortes et
conduisirent à quelques variations de dates avec la réalité astronomique,
jusqu’à ce que l’église soit en mesure de christianiser les fêtes païennes et
d’en définir les dates (en s’inspirant fortement des coutumes druidiques).
Ainsi 4 feux vinrent marquer l’année : -
l’équinoxe de printemps ou quadragésime, le premier dimanche de
Carême (qui commence 40 jours avant Pâques), soit la mi-mars, plus connu sous
le nom de « Bordes » ou de « Brandons » ou encore de « Bures ».
Ces trois termes ramènent à la même idée de feux, qu’ils soient de branchages, de fagots ou autres végétaux. La Borde, c’est aussi une maison construite avec du
bois et du branchage et le bordage, le droit seigneurial octroyé à une borde.
Jadis un village était mesuré au nombre de ses feux,
autrement dit au nombre de foyers d’habitation, donc au nombre de maisons.
- le solstice de juin, le 24 juin (St Jean-Baptiste) d’où les feux de la St jean. Sans doute pour rappeler la force et la puissance du
feu, une légende morvandelle raconte que l’épilepsie serait également appelée «
mal de St-Jean ».
Le saint ayant voulu examiner de près la nature du tonnerre, il en aurait éprouvé une telle frayeur qu'il aurait été atteint subitement du mal. - l’équinoxe d’automne, le 29 septembre (St Michel) aussi appelé feu des bergers. - le solstice d’hiver, le 25 décembre (ou quelquefois le 6 janvier, jour de l’Épiphanie) appelé « Boeudiré ». Certains auteurs avancent que les danses (les rondes)
exécutées autour des feux étaient intimement liées au culte solaire, soit !
Mais alors, avant Monsieur Galilée, pourquoi
tournait-on déjà autour du soleil ?
Disons simplement que le contraire n’eut pas été facile… Quelques autres feux- La bûche de Noël :
Cette coutume remonterait à l’antiquité et aurait par
la suite été « christianisée ».
Elle consistait à placer dans l’âtre, en tout début de veillée de Noël, la plus grosse bûche que l’on put trouver (mais préparée à l’avance), « le plus gros rondin ou la plus vieille souche », de manière à ce qu’elle se consume le plus longtemps possible. Ainsi, tant qu’elle brûlait, le bonheur était dans la
maison.
En Morvan, ce que l’on appelait « Lai cheuche de noé » (la bûche de Noël) devait brûler jusqu’au jour de l ‘an. Chaque matin il fallait absolument raviver le feu et
le redémarrer, et si par malheur il ne repartait pas ou pire encore, s’il
s’était éteint dans la nuit on y voyait un très mauvais présage.
Avant de se rendre à la messe de minuit, l’ancien de la famille se devait « d’aiteujer les teujons » (d’attiser les braises) en faisant le plus « d’éveillées » (d’étincelles) possibles tout en rappelant le dicton : « Eveilles, éveillons, Autant
de gerbes que d' gerbeillons ! ».
En clair, on espérait que la moisson rapporterait
autant de grosses et de petites gerbes que la bûche pourrait lancer de grosses
et de petites étincelles.
Ensuite, une fois la bûche quasiment consumée, on en récupérait quelques débris qui étaient conservés précautionneusement. En effet, au cours de l’année, par temps d’orage – et
de tonnerre – on en plaçait un des morceaux sur le feu et là, la fumée qui en
émanait s’échappait par la chemisée et dispersait les nuages en se mêlant à
eux…
Facile !
Fautes de disposer de ces « teujons », il restait toujours les recommandations de « l’évangile des quenouilles » (Recueil de dictons populaires que les femmes du XVème siècle se racontaient à la veillée, en filant leur quenouille) qui préconisait de disposer quatre bâtons de chêne qui s’enflammeraient en dégageant de la fumée et de réciter un pater et un ave : « Quant femmes voient que
tempeste se liève en l'air, elles doibvent faire du feu de quatre bastons de
quesne en croiz en sus du vent et bénéir le vent et il emportera la tempeste au
loing ».
Les solutions de rechange (homologuées ?) ne
manquaient pas, il semblerait qu’une simple prière, «
la peurière de Sainte Mairguite » (la prière de Sainte Marguerite)
convenait aussi parfaitement, mais elle est plus longue et se termine ainsi :
"...Partô laivou qu' lai boune sainte Marguite Seré dite O n'i paisseré ne tempête, ne
foulise, ne aute cetite béte ; nos lé conduron chi loingn' por délai, délai mer, que ran n' sen sentiré pu qu' lai ronce et l’ çardon..." Il n’en demeure pas moins que ces fameux « teujons » avaient de multiples autres pouvoirs : éviter la vermine dans les jardins, écarter les rongeurs des céréales, détruire les charençons, éviter les serpents, aider au vélage et bien d’autres choses encore… Aujourd’hui plus de grandes cheminées et peut-être bientôt plus de foyers ouverts. « Lai cheuche de noé » semble avoir de plus en plus de plomb dans l’aile et de moins en moins de bois dans l’âtre. Ce serait en 1879 qu’un pâtissier français dénommé Pierre Lacam, pâtissier de son Altesse Sérenissime Charles III Prince de Monaco, eut l’idée de perpétuer cette tradition en remplaçant la légendaire bûche à brûler par une autre à manger. Contrairement à la famille princière, Pierre Lacam
n’aurait pas eu de descendance en mesure ou en goût d’assurer sa succession.
Une autre version, très répandue, affirme que c’est en
1945, qu’un pâtissier dont le nom n’a pas survécu, aurait « inventé » ce gâteau
dont une variante, le gâteau roulé de Noël, était déjà de tradition
charentaise.
- Les feux follets : Si, par extraordinaire, des propriétaires indélicats
avaient quelque peu déplacé des bornes dans le but de s’approprier un peu du
terrain de leur voisin, la nuit de petits feux follets s'en échappaient et
faisaient ainsi connaître le détournement.
Une autre version attribue cette manifestation aux nouveau-nés morts avant d’avoir reçu le baptême qui, au lieu de devenir Anges au paradis devenaient des « queulars », des feux follets, personnages de l’enfer qui hantaient les mares et les étangs. Ces « queulars » cherchaient à vous encercler dans le
but de vous faire tomber à l’eau et de vous noyer.
Là encore il était facile de leur échapper en jetant
une pierre ou un bâton dans l’eau.
Les « queulars » se précipitaient au point de chute ce
qui vous permettait de vous enfuir, généralement à toutes jambes.
L’âme de ces enfants qui ne recevaient pas de sacrement, pas d’office religieux, non plus de sépulture chrétienne rejoignait les limbes. Aussi, pour gagner quelques temps lorsque l’avenir du
nouveau-né semblait compromis, on avait recours à l’ondoiement.
Cette « action d’urgence » permettait de baptiser
(provisoirement) l’enfant sans observer les cérémonies du baptême mais lui
offrant d’aller au ciel et de pouvoir être inhumé chrétiennement.
Il y avait toujours une solution. - Le tourmenteur : Une curieuse formule pour découvrir un tourmenteur fut
un jour donnée par un « artisan » sorcier.
« A minuit vous allumerez le
feu à un buisson proche de votre ferme et le premier qui se présentera sera
votre tourmenteur. »
Ainsi fut fait, ce qui permis de mettre la main sur le
premier qui se présenta… avec un seau d’eau… Le culte de l'eauAux temps les plus
reculés, l’homme a vécu sans le feu, mais il avait de l’eau !
Les lacs et les cours d’eau furent probablement et pendant longtemps une importante réserve de nourriture, mais ils servaient aussi et surtout à se désaltérer, à s’hydrater dirions-nous aujourd’hui. Plus importantes et plus extraordinaires encore étaient les sources, jaillissant miraculeusement de nul part. Elles furent l’objet d’un culte aussi puissant que
celui du feu et sont à l’origine d’innombrables légendes.
Il était jadis de coutume de déposer des offrandes dans les eaux, généralement des pièces de monnaie, afin s’attirer quelques faveurs des dieux. Il existe de nombreux exemples de haches et de silex trouvés dans ou aux abords des fontaines, vraisemblablement des offrandes aux dieux des lieux. Ces découvertes confirmeraient l'idée d’un culte des eaux déjà pratiqué en Gaule au temps de la pierre polie. C’est le cas de la fontaine de « Fontaine-Sauve » (le
nom rappelle la croyance à des propriétés curatives) à Vic-de Chassenay, près
de Semur, au Nord du Morvan.
Aujourd’hui, la Fontaine de Trévise en Italie en est le symbole touristico-légendaire parfait. Généralement, une fée malfaisante se tenait aussi à proximité, sous de vieux arbres, à l’entrée d’un vieux et mauvais chemin aux noms souvent évocateurs. Pour contrer cet engouement des populations pour ces croyances, l’église n’avait d’autre solution que de procéder comme pour le feu et de « christianiser » les sources. Joseph Bruley dans son ouvrage « Morvan, cœur de la France » , nous rappelle cette lettre que Grégoire-le-Grand aurait adressée au VIème siècle aux missionnaires bretons : « Il faut se garder de
détruire les temples des idoles, il faut y construire des autels et placer des
reliques, car tant que la nation verra subsister
les anciens lieux de dévotion, elle sera plus disposée à s'y rendre, par un
penchant d'habitude pour y adorer le vrai Dieu.
»
Pierre Canavaggio dans son livre « Le guide des superstitions », nous annonce sensiblement la même chose : « … Vers l'an 600,
l'archevêque de Cantorbéry prescrivit aux prêcheurs chargés de rameuter des
ouailles chrétiennes :
Ne détruisez pas les temples, baptisez-les d'eau bénite, dressez-y des
autels ; là où le peuple a coutume d'offrir des sacrifices à ses
idoles diaboliques, permettez-lui de
célébrer, à la même date, des festivités chrétiennes. »
Rien ne changea donc au quotidien, simplement au fil du temps les vocables sous lesquels elles étaient placées prirent le pas. En Morvan, ce sont des centaines de sources qui ont ainsi glissé de la « divinité » à la « sainteté ». Nous pouvons toutefois nous demander si nous-même ne prolongeons pas quelque peu ce culte, ainsi cette phrase dans un Procès-verbal de séance de la Société Eduenne du 1er février 1888 : « … Quant à la statuette de
Mercure, elle a été trouvée dans le lit de la rivière de la Canche, où une main
gauloise dut la jeter jadis comme ex-voto. Le
bronze porte la trace du contact pendant de longs siècles avec les graviers et
les cailloux roulés par le torrent.
Selon M. Bulliot, c'est un
témoignage curieux du culte rendu par nos ancêtres aux divinités des sources du
Morvan, et dans le cas particulier à celle de la
Canche. … »
Parmis toutes les possibilités qui ont pu conduirent à ce que la statuette se retrouve à cet endroit, seule celle de l’offrande est retenue. Parisiens, vous devez aimer profondément votre Seine pour y jeter tant de choses… Quelques fontaines, sinon miraculeuses, au moins extraordinaires- A saulieu, la fontaine St Jacques :
Une légende raconte que « quiconque boira de l'eau de
ce puit sera en bonne santé et protégé toute l'année ».
Paradoxalement, cette fontaine se trouvait (se trouve
encore…) à l’entrée Nord de la ville, à proximité d'une léproserie qui ne fut
détruite qu‘en 1736 et dont l’emplacement se situe probablement au niveau de
l’actuel hôpital.
Les croisés se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, s'y arrêtaient régulièrement –dit-on- afin de boire cette eau « protectrice ». - A Alligny, la fontaine de la Chapelle Saint-Franchy : Ancienne fontaine sacrée de l'oppidum, elle était
l'objet d'une procession annuelle et a aujourd’hui complètement disparue.
Elle aurait jadis été réputée pour guérir la fièvre.
On y allait en pèlerinage, à jeun, le lundi de
Pentecôte. On y jetait quelque argent puis on y déjeunait de pain et d’un œuf
dur dont la moitié servait d’offrande.
Le reste de la journée se serait déroulé de manière
plus « festive » voire « beaucoup plus festive encore » amenant le curé à
interdire ce pèlerinage « pour cause de scandale ».
Faute d’intérêt populaire, cette coutume s’est alors
perdue.
- Près de Moulin-Engilbert, la fontaine de Chaumes : Comme d’autres, cette fontaine aurait eut le pouvoir
de donner ou de redonner du lait aux nourrices.
Toutefois, bien en avance sur son temps, cette
fontaine aurait eut ce même pouvoir pour celles qui, ne pouvant s’y rendre en
personne, envoyaient pour l’y tremper, une chemise du nourrisson à allaiter…
Aujourd’hui des marabouts dépannent bien vos ordinateurs par la pensée… Impressionnant ! Mais rien ne dit si la dite chemise était récupérée
par la suite…
- A Mhère, Près de Corbigny : Là se trouvait une source fécondante où les jeunes
filles souhaitant se marier dans l’année et les jeunes femmes désireuses d’être
mères se rendaient en procession dans le seul but de boire son eau.
Cette source fut paraît-il par trop fécondante et le
Baron Dupin, propriétaire des lieux, dut faire défricher tous les abords afin
que les couples ne puissent plus s’y égarer, ce qui eut pour conséquences de
tarir, non point la source, mais bien la procession.
- Toujours près de Moulin-Engilbert : Outre le fait de guérir de la colique, la source de
Saint-Gevras (Saint-Genevra ou Saint-Gervais) était réputée pour favoriser la
pluie ou le beau temps selon les besoins locaux des cultures (le miracle
sélectif…).
En plus de s’y rendre en procession, la coutume, pour le moins curieuse lorsque la pluie se faisait trop attendre, consistait à jeter l’antique statue du saint dans le bassin de la fontaine. Non mais des fois… - A Corbigny : La particularité de la fontaine Sainte-Agathe aurait
été d’accueillir les nourrices ayant déjà beaucoup œuvré et dont le lait était
épuisé.
La coutume voulait aussi qu’à la Sainte-Agathe on ne
file et ne lave point pour ne point « brûler » ni « noyer » les enfants…
Ça c’est de la prudence ! - A Saint-Honoré-les-Bains : La fontaine de Tussy a longtemps été réputée pour
guérir les atteintes aux voies respiratoires mais aussi la fièvre.
Le malade devait s’y rendre « en personne », sans être
vu « d’âme qui vive ».
Il devait y saluer ainsi la fontaine : «Bonjour, fontaine, donne-moi ton bonheur, comme je te
donne mon malheur », faire trois fois le signe de la croix au-dessus de la
source, puis pratiquer ses ablutions, boire de l’eau et enfin lancer une pièce
de monnaie par-dessus l’épaule gauche avant de repartir sans se retourner. …
L’échange bonheur-malheur n’est pas très équitable et il n’est pas dit avec quelle main on doit jeter la pièce… - Au Mont Beuvrey : La fontaine Saint-Pierre, où les nourrices venaient
baigner leurs seins, était, elle aussi, réputée pour provoquer une abondance de
lait.
- A Entrain sur Nohain, en nivernais : La fontaine d'Entrains avait les vertus de guérir «
toutes les maladies de poitrine » et donc probablement aussi d’aider les
nourrices.
- A Faubouloin, près de Corancy : La Fontaine Notre-Dame avait d’autres atouts.
Elle voyait les femmes apporter un gâteau de miel pour
rappeler leurs ruches essaimées.
Les femmes apportaient aussi un peu de laine en vue de
guérir les brebis de leurs calamités.
Elle pouvait également y jeter la chemise d'un malade,
si la chemise flottait, il recouvrerait sans doute la santé, sinon…
Une fontaine « multitâche » en somme. - Toujours à Faubouloin, près de Corancy : La Fontaine du Frêne permettait aux « bitous », aux «
chassieux » (maladie des yeux) ainsi qu’aux « bavous » (ce terme ne figure
pas dans le « Chambure »), de voir la fin de leurs misères, à condition qu’ils
piquent une épingle dans un frêne tout proche.
Il semblerait que les femmes piquaient aussi une
épingle dans ce frêne pour « avoir des chances d’être aimées… »
Cette coutume de l’épingle plantée rejoint la superstitions du clou et remonterait à l’antiquité. Tite-Live (Titus Livius né en 59 avant notre ère et décédé en 17 après) en aurait parlé dans « Ab Urbe condita libri », « Histoire de Rome depuis sa fondation » (je n’ai pas vérifié, cet ouvrage comporte… 142 livres) et rapporterait que les clous plantés éloigneraient des dangers tels que la peste et symboliseraient la fin du mal « cloué » sur un arbre. Et quelques autres fontaines se distinguaient particulièrement : Gouloux : Contrairement à toutes (ou presque) les fontaines du Morvan, celle de Gouloux avait une fâcheuse réputation, celle de rendre fou tous ceux qui se risquaient à boire de son eau. Cette particularité était partagée avec la fontaine de
Bierre-l’Egarée (Côte
d’Or).
- A Guenichey (près de Sermaize) : La Vouivre habitait la fontaine, la rendant «
malfaisante ».
Et à la source du Boué à Pichanges : L’eau était si froide qu’elle rendait idiot...
Rien ne dit comment étaient « affichées » les mises en garde… Il faut quand-même se méfier ! Plus généralement, car tout était prévu, on pouvait se rendre au bord d’un ruisseau ou d’une rivière (puisque tous avaient leur dieu…), s’agenouiller comme il convient, saluer en disant « Bonjour rivière » en l ‘appelant par son nom, puis commencer le rituel : Aspirer une gorgée d’eau avec laquelle on se rince la
bouche et que l’on rejette après, reprendre une gorgée que l’on avale cette
fois puis en reprendre une troisième pour à nouveau la rejeter, le tout en
disant :
« Tiens rivière, voilà ma
fièvre, tu me la rendras quand ton cours remontera ».
Là encore il y a un arrière goût de marché de dupes. A voir également mon appli réalisée sous Google Map à partir des travaux de Roland Niaud à cette adresse : https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10BrZ_3Lth7AxureS_wpy81sXnpY&ll=47.2905080450503%2C4.18214999999996&z=8? target=" Le culte des arbresQuelle pourrait-être la
raison de ce culte ?
Depuis longtemps, l'homme a compris que l’arbre était remarquable. Non seulement il utilise tous les éléments, eau, air
et terre, mais le feu il le donne aux hommes : le bois.
- Les Celtes auraient utilisé un calendrier basé sur les cycles lunaires et associé un arbre à chaque mois lunaire. Le problème est qu’ils n’auraient laissé aucun
éléments sérieux pour en attester.
Ces affirmations relèveraient donc elles aussi de la
légende et de l’imaginaire.
- Les druides cueillaient, paraît-il, du gui sur les chênes (avec une serpe d’or…), pourtant ce n’est pas sur cet arbre que le gui prolifère le plus. Légende ?
- Comment ne pas penser à « l’arbre de justice » et à ce (bon) Louis IX dit Saint Louis qui, à Vincennes, rendait la justice sous un chêne ?
- Comment ne pas penser non plus au fait que beaucoup
de pendus l’étaient à un chêne ?
En bordure du Morvan, Montréal fut mis à feu par les
hommes des Ducs de Bourgogne et beaucoup furent pendus au « chêne de la peur… »
Le chêne serait-il le roi des arbres ?
- A la fin du VIIème siècle, selon la légende, Saint Boniface, moine évangélisateur allemand, aurait fait abattre un chêne pour convaincre les druides germains que ce n’était pas un arbre sacré. En tombant, le chêne écrasa tout ce qui se trouvait
sur son passage, sauf un jeune sapin qui devint ainsi miraculeux et nommé «
arbre de l’enfant Jésus ».
L’église venait de retourner un symbole. >
Si l’on considère que dans le rite païen, un arbre était un symbole de vie et que, lors du solstice d’hiver l’un d’eux était décoré avec des fruits, du blé et des fleurs, le sapin de Noël venait d’être inventé… Pline l’ancien quant-à lui écrivait : « nec non et in quodam usu
sacrorum religious et fagi cortex », l’écorce du hêtre a aussi certains
usages religieux…. Il faut aussi de souvenir qu’à la révolution on mit en évidence d’autres arbres, les arbres de la liberté. Ces arbres qui, comme à Château-Chinon, furent les
témoins de la stupidité des commissaires représentants de la république qui y
firent brûler les archives en présence du peuple obligé de crier « vive la
République, la Convention et les Commissaires… »
Les forêts étaient les lieux où les druides enseignaient le jour mais aussi où l’on se rendait la nuit pour recevoir le prêche d’antiques croyances délivrées par d’autres druides moins respectables. C’est également dans les forêts profondes que les loups-garous se transformaient, bien sur grâce à de diaboliques et mystérieuses incantations. Le chêne était deux fois « arbre sacré » lorsqu’en plus un essaim d'abeilles y avait trouvé refuge. L'abeille était probablement venue en réponse à une
prière des druides.
Elle offrait son miel, thérapeutique suprême, mais
aussi base d’un hydromel non dénué d’intérêt.
Il ne manquait, paraît-il, qu’un pivert pour nettoyer
les abords de l’essaim pour que la sacralité soit établie et que l’on vienne
honorer cet arbre.
Le culte des pierres Il ne s’agit pas à
proprement parler de culte des pierres mais quasi exclusivement de légendes.
Les Pierres étranges et extraordinaires que l’on trouve en Morvan ne sont que des pierres naturelles en place depuis des millénaires. Certaines ont été taillées par les hommes, d’autres modelées par l’érosion et toutes sont associées à des légendes, à des sorcières, à des divinités ou des saints. Sans entrer dans un décompte fastidieux, disons que le Morvan profond est probablement le mieux fourni puisqu’on trouve 1 pierre remarquable en Côte d’Or, 46 dans la Nièvre, 11 en Saône et Loire et 2 dans l’Yonne. Quelques pierres légendaires
- A côté de Précy-sous-thil :
Près de Saulieu, en bordure du Morvan, se trouve le
ravin de la Galaffre, résidence de la Boefnie (Beuffenie).
Cette vilaine fée y logeait et se manifestait aux
voyageurs à minuit en leur réclamant du sel et du pain.
La légende dit que les pierres étranges qui demeurent
en cet endroit ne sont que son lit, son siège et sa marmite qu’elle transforma
ainsi le jour de son départ mais qu’il ne faut toutefois pas oublier d’avoir un
peu de sel et de pain sur soi si vous y aller de nuit.
- A la Roche en Brenil : Les rochers du Poron-Meurger. Le Diable aurait fait un pari avec Dieu. Bloquer la
sortie de l’église avant la fin de la messe avec un énorme rocher provenant de
l’étranger.
S’il réussissait, les âmes de tous les paroissiens lui
appartiendraient.
Seulement, comme il arriva en retard, il jeta son
rocher dans la foret voisine, rocher qui porterait encore l’empreinte de ses
doigts et de ses épaules.
- A Chiddes, Glux-en-Glenne, Larochemillay, Lavault-de-Frétoy, Saint Martin etc : Ce bon saint Martin en se déplaçant pour porter la
bonne parole a laissé l’empreinte de son âne un peu partout.
Appelées « Pas de l’âne », « Pierre du pas de l’âne »
ou encore « Souliers du Bon Dieu », on ne voit là que des traces naturelles
dans le granite.
- A Alligny-en-Morvan, Château-Chinon, Franvache, Préporché, Saint-Agnan, etc : Des pierres en forme de dolmens dont on ne sait pas
encore avec certitude s’il s’agit de « constructions » ou de simple «
empilements naturels » mais dont certains auraient réellement servit d’autels
sacrificiels.
- A Pierre-Perthuis : Une arche naturelle, véritable curiosité géologique,
sans aucune légende associée (c’est assez rare pour être signalé) et dont la
silification remonterait à environ 185 millions d'années.
- La pierre de Couhard : Situé à proximité de la voie Autun-Lyon, ce monument
de forme pyramidale, dominait une des nécropoles de la ville, « le Champs des
Urnes », ainsi dénommé en raison des nombreuses urnes à incinération
découvertes depuis, lors de labours.
Il est aujourd’hui admis qu’il s’agit d’un monument
funéraire datant du 1er siècle de notre ère.
Le mystère reste entier sur sa nature d’origine :
mausolée ? (Mais aucun vestige funéraire n’a été retrouvé) ou cénotaphe ?
(Monument funéraire élevé dans un lieu où ne se trouve pas le corps).
- La Pierre qui Vire : La légende de la Pierre qui vire existe depuis la nuit des
temps.
Chaque année lors de Noël, dans l’intervalle des douze coups de minuit de la cloche de la chapelle de Vaumarin, la partie supérieure du rocher tournait sur elle-même, découvrant une crypte débordant de prodigieux trésors. Cette légende prétendait qu’il était possible d’y puiser tout son saoul le temps que la cloche sonne ses douze coups... Si vous voulez connaitre la suite, recherchez l’histoire de Persevine et de son enfant…
La pierre supérieure fut scellée en 1853 par le Père
Muard afin d’y dresser la statue de « Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire »… et
faire cesser définitivement cette légende. Cette statue initiale est maintenant placée à l’entrée de l’église, une nouvelle, plus récente l’a remplacé. Les messesAu risque d’en
offusquer certains, la messe a sensiblement les mêmes buts que les antiques
cérémonies païennes : rendre hommage, remercier, implorer le pardon, obtenir
des grâces et des faveurs et affirmer sa foi.
La simplification réside juste dans le dieu (et le
lieu) unique.
De nos jours, nous assistons encore à des cérémonies dont les origines semblent pourtant sorties tout droit du passé : Les pardons et les processions. Les processions suivent généralement des bannières, des cierges allumés et des statues, et se terminent souvent par une bénédiction et un repas sur l’herbe. Les pardons, probablement beaucoup plus nombreux,
débutent par une messe (en plein air) et se poursuivent par une procession avec
bannières, croix et statues de saints portées par des gens en costume
traditionnel.
Une fête profane accompagne fréquemment ces fêtes
religieuses.
Il n’en demeure pas moins que, la plupart glorifient des saints locaux en raison de leur prédisposition à soigner ou à protéger certains groupes de personnes ou d'activités. On a beaucoup changé la forme, mais le fond… - Dimanche des Rameaux : Le vent qui souffle le jour des Rameaux, pendant la
lecture de l'Evangile des Rameaux lors de la grand-messe, sera le vent dominant
de l'été.
- A Alligny : Des pèlerins venaient faire dire une messe en
l’honneur du saint le jour de la Saint Roch dont la statue, haute d’une
quarantaine de
centimètre, était abritée dans l’église. Ils
espéraient en contrepartie une bonne conservation du bétail mais aussi la
préservation contre bien d’autres fléaux comme le laisse entendre cette
peurière (prière) :
O saint Roch, vray preservateur de feu, bossë, epydimie,
je te requiers de tres bon
cueur
que tu me preserve et ma
lignie.
Mon bestial et ma
mesniemect tout en ta protection,
en priant Jhesus et
Marie
que de peste franc nous
soyons.
Amen
Procession de Liernais et d'Alligny : Chaque année, à une date incertaine, les habitants de
Liernais et d'Alligny organisaient une procession allant l’une à la rencontre
de l’autre.
Chaque procession était précédée de sa bannière.
La première des deux qui était aperçue de loin, celle
qui avait levé sa bannière au plus haut, gagnait ainsi du bonheur pour l’année.
Les êtres démoniaques ou porte-malheurIl serait, paraît-il,
facile de reconnaître une personne possédée par le malin.
« Posez-lui une question en latin, elle vous répondra
en français ».
Donc si le lui dis simplement « Do tibi loqueris ? »
(Parlez-vous latin ?) Elle devrait me répondre « oui » en français…
Sauf que le peuple ne parlait pas latin et ne
disposait pas (comme moi) de Google traduction.
De là à regarder si son regard était fixe, ses doigts
trop plats et son visage enflé, trop tard, la peur vous avait envahit.
Le loup : Il est évident que les loups ont longtemps habité
(hanté) les vastes et denses forets du Morvan.
Certaines maisons disposaient sur le toit d’une «
tuile à loups » qui sifflait avec le vent du Nord et annonçait l’arrivée des
meutes.
Cet animal n’était pas le bienvenu et dans la maison
deux instruments l’attendaient :
- « la fourche à loups », une fourche à deux dents
particulièrement résistante,
- « la rhombe », aérophone que l’on faisait tourner au
bout d’une cordelette et qui produisait un vrombissement destiné à les
effrayer.
Chose étrange, une version de cette rhombe est
appelée… « Diable »
La bête était chassée et chaque dépouille payée par l’état. Ainsi nous retrouvons ceci dans : https://www.gennievre.net/wiki/index.php?title=ev%c3%a9nements_dus_aux_loups"
target=" Nièvre – an VI : Référence : Jean Marc Moriceau, L'homme contre le loup. En l'an VI, le
département de la Nièvre déclara 355 loups tués : 2 loups enragés, 11 louves
pleines et 36 non gravides, 46 loups et 260 louveteaux !
Le ministre n'en fut pas dupe. Dans une lettre
adressée aux administrateurs nivernais, il écrit :
« Je sais que votre
département est couvert de loups, mais j'ai lieu de soupçonner qu'on m'a fait
payer des jeunes renards pour des jeunes loups. Les deux espèces, quelques jours après leur
naissance, se ressemblent tellement qu'on peut s'y tromper »
La vouivre : Eugène de Chambure nous livre la définition de la
Vouivre par un académicien, M. Marmier :
« La vouivre est un serpent ailé, un être magique qui
se glisse dans les airs comme une lueur rapide, se baigne dans les flots comme
une autre Mélusine et porte à son front une escarboucle plus précieuse que tous
les diamants de la couronne de France... ».
Le serpent : C’est le symbole du mal, le premier animal identifié
au Diable, le serpent de la bible, le tentateur.
La Genèse 3-1 :
« Or le serpent était le plus
fin de tous les animaux, des champs que l’éternel avait fait ; il dit à la
femme : Quoi ! Dieu aurait dit :
Vous ne mangerez point de
tout arbre du jardin ? »
Vous connaissez la suite… Notez que le serpent, animal monstrueux, représentation du vice et souvent apparenté au dragon, est régulièrement vaincu, dans toutes les légendes… également par les premiers représentants de l’église dans les villes christianisées. Plus sinistre est l’adversaire, plus grande est la gloire… Une croyance largement répandue dans les campagnes affirme que les serpents adorent le lait et que certains iraient jusqu’à boire directement aux pis des vaches et les feraient tarir. Il semblerait pourtant que les serpents ne soient pas
aussi friands de lait qu’on veuille bien le dire.
En revanche, ils sont attirés par la chaleur de
l’étable.
La pie : Si une pie traverse le chemin d’un cortège de mariage,
un malheur traversera aussi la vie des mariés.
La chouette : Toujours considérées comme des oiseaux de mauvais
augure.
Si elles se font entendre le soir ou à la tombée de la
nuit, un membre de la famille mourra bientôt.
La chauve-souris : Les gens des campagnes les jugent très venimeuses.
Si elles vous urinent dans les yeux le soir, vous
deviendrait aveugle.
Là c’est pas de chance ! Ça me rappelle l’histoire de
celle qui avait trouvé le numéro du digicode d’un célèbre humoriste…
La Bête à Blaisot : (la Bête du Morvan) La "Bête du Morvan" sévissait sur les hauteurs
d’Anost, en haut de la côte de Monloin chère aux Galvachers.
"...elle était connue sous le
nom de Bête à Blaisot, chèvre par la tête et loup par le corps.. Ce monstre
prenait parfois l'apparence d'un loup de haute taille, à poil fauve, efflanqué, avec des
yeux de braise, une gueule démesurée et une langue pleine de sang..."
Et le monstre avait bien sur le pouvoir de se changer en bête docile, était doté de la parole et avait aussi le don d'ubiquité, ce qui laissait à chacun tout loisir de l'avoir vu en même temps en divers endroits. Mais fort heureusement, certaines formules toutes simples permettaient néanmoins d'éloigner la créature : "Ch'teu l'bon Dieur, cause ; ch'teu l'Diabe, pesse". Si tu es le bon Dieu, parle ; si tu es le Diable,
passe. Quelques exemples… En vrac !En vrac oui, parce
qu’il paraît bien délicat de les classer de manière formelle dans l’une des
catégories Coutumes, Croyances ou Superstitions, surtout lorsqu’elles peuvent
être les 3 à la fois.
Dans ces exemples, n’oubliez pas non plus la loi de «
Murphy », celle que vous connaissait mieux sous le nom de « Loi de la tartine
de confiture », la fameuse tartine qui tombe toujours du côté de la confiture.
Autrement appelée « loi des séries » ou mieux encore «
LEM » (Loi de l’Emmerdement Maximum), c’est celle qui attend que vous
changiez de file de voiture pour que celle où vous étiez se mette subitement à
avancer, celle qui augmente le retard ou l’avance que vous aviez au départ,
celle qui voit arriver le bus alors que las d’attendre vous êtes parti
prendre le métro, celle qui fait que vous n’avez plus d’eau chaude à la
douche au moment de vous rincer… et tant d’autres…
Jadis on aurait affirmé sans crainte qu’il s’agissait de sorcellerie ou d’envoûtement. De nos jours, astrologie, cartomancie, chiromancie et même voyance ont toujours le vent en poupe, c’est donc bien que l’on y croie… Ou pas !
N’oubliez pas non plus que quelqu’un a déjà dit : « Moi, je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur ! ». - Les crouyottes (les croïottes) : « … Des tiges dont ils ont
adroitement formé des bouquets verts avec une croix au sommet… »
C’est ainsi qu’Alphonse Bourgoin décrivait les
crouyottes dans l’un de ses poêmes.
Il y a maintenant une centaine d’année, les familles plaçaient ces fameuses « crouyottes » dans leurs champs de céréales pour les préserver de la grêle et d’autres fléaux.
Le « dimanche des crouyottes » se situe le premier
dimanche de mai, avant le dimanche des « Rogations ».
Le mercredi, veille de l’Ascension, le maître de
maison confectionnait les crouyottes avec de jeunes branches de noisetier.
Le lendemain, on les emmenait à la messe où elles
étaient bénies.
L'après-midi la famille les emportait et les piquait
au milieu de leurs champs en y ajoutant une prière.
Une fois ce rituel accompli, tous se retrouvaient sur la place du village et partageaient ce moment d’espoir en diverses activités ludiques. Le temps de la moisson arrivé (moisson à la main, à la
faucille ou au ratelot), plusieurs coupeurs étaient placés de front sur un «
ordon » (ligne de travail dans un champs où plusieurs ouvriers travaillent de
front).
Chance pour celui qui tombait le premier sur la «
crouyotte », il lui restait à prendre le chapeau d'un autre coupeur pour «
chapeauter la crouyotte ».
Il se trouvait alors quelqu’un tête nue qui devrait
payer à boire ou un tour de chevaux de bois lors la fête patronale (
généralement à la St Barthélémy ).
Les dernières « crouyottes » auraient été plantées
dans les années 1960 dans les hameaux de Montsauche.
Personne ne rapporte l’efficacité du procédé mais au moins il n’avait rien de toxique … Les Rogations : Du latin « rogare » le terme signifie « demander »
Ce sont les 3 jours qui précèdent immédiatement le
jour de l’Ascension (le jeudi) et au cours desquels avaient lieu des
processions, notamment dans les chemins et les champs, mais aussi des messes
afin demander que les récoltes soient épargnées.
Eugène de Chambure nous explique que, « …Selon la croyance populaire, les prières des trois journées des Rogations intercèdent successivement pour les trois grandes époques de l'année agricole : 1° « lai fouâchîon » (ou
fouâcïon, les fauchaisons)
2° « lai moichon » (la
moisson),
3° «lai m'nïon » (dernières
récoltes d'avoine et de blé noir et les semailles d'automne..) ». <
- Le baromètre médico-sentimental : En Morvan, le mercure (qui porte le nom de « Mer du
diable ») était employé pour se protéger du malin.
On le mettait dans un pot fermé puis on le plaçait
dans un coin de l’écurie qui passait pour être ensorcelé (en Morvan on parle
rarement d’étable ou de bergerie, c’est l’écurie des vaches ou l’écurie des
moutons…).
Mais en réalité personne ne dit, ou n’ose dire, si ça
marche… ou pas !
En revanche, une autre application semblait être dévolue à ce métal liquide, une application qualifiée « d’infaillible moyen de diagnostic », un moyen utilisé par les maris doutant de leurs épouses. On le place cette fois dans un étui à aiguilles
appartenant à la dame objet de tous les soupçons et on le porte sur soi.
Si le mercure s’en échappe, le doute est confirmé.
Le mercure, probablement de par sa structure, était jadis largement utilisé pour préserver de toutes sortes de maux dont le choléra et les convulsions. Pour cela il était placé dans toutes sortes de
contenant plus surprenant les uns que les autres : coque de noisette, plumes ou
autres fioles. …
Depuis des siècles… Pollueurs ! > - Achat du vendredi : Il paraît que les Morvandiaux n'achetaient jamais
leurs costumes, toilettes et bijoux de noce le vendredi.
Si l’on n’y prenait garde, l'un des époux mourrait
inéluctablement dans l'année.
Même sentence d’ailleurs si on liait des bœufs le jour de la Fête Dieu. Idéal pour la rime, « A la Fête Dieu on ne lie point
les bœufs »
Toutefois aucune « statistique » ne confirme les faits. - Mariage du mois de mai : Le mois de mai était généralement évité pour toute
union car ce mois « empêche d’avoir des enfants… ».
On l’aurait aussi appelé « le mois des ânes ». - Le Croque-aivoigne et les accordailles de fiançailles et de mariage : Tout d’abord, Eugène de Chambure nous apprend que le
Croque-aivoigne (ou Croque-avoine), est celui qui sert d'entremetteur pour un
mariage, qui fait les premières démarches auprès des parents de la jeune fille
(et par voie de conséquence, assiste à tous les repas…).
Il nous apprend ensuite que glisser quelques grains d'avoine dans la poche de son galant est pour la fille (dans les Hautes-Alpes) signifier un congé en bonne forme et sans éclat. De nos jours nous pourrions rapprocher le Croque-aivoigne d’un pique assiette et le congé d’une « avoinée », d’une correction. Ce Croque-aivoigne donc, devait sonder les parents des deux parties, enquêter sur les situations, les possibilités de dot, les dettes, et « établir un bilan ». Si ce bilan n’était pas trop négatif pour l’une des
parties, le jeune homme était invité, accompagné de son Croque-aivoigne, dans
la famille de la jeune fille.
Là commence alors, non pas un dialogue, le morvandiau
n’est pas bavard, mais un jeu de signes :
- Si l’on écarte les tisons dans la cheminée, on boit
peut-être un canon mais il n’est pas question de casse-croûte et encore moins
de
mariage.
- Si l’on fait des croix dans la cendre et que l’on
propose un repas fait de crapiaux et de fromage blanc, ce n’est pas gagné, le
mariage est mal engagé.
- Si les tisons sont rassemblés et le feu ravivé,
c’est que l’affaire se présente bien.
Il est question alors de nappe blanche, d’omelette au
jambon, de poulet, de tarte et de vin bouché. La fin des négociations attendra
la fin du repas.
On remplit le verre du jeune homme qui en boit la
moitié, offre le reste à la jeune fille qui le prend et le vide (cul-sec).
L’affaire est faite et la suite prend alors « un cours
normal ».
- Au bal : Dans son ouvrage « Le guide des superstitions »,
Pierre Canavaggio, nous dit qu’en Morvan un jeu entre jeunes gens consiste à se
heurter hanche contre hanche mais n’oublie pas de préciser que « ce jeu amoureux peut devenir brutal : les morvandelles
sont souvent costaudes… »
- Le coucou : A la fois superstition et coutume particulièrement
vivace puisqu’elle perdure de nos jours.
Le coucou serait un oiseau de mauvais augure puisqu’il
ne faut être ni à jeun, ni sans argent en poche lorsqu’on l’entend chanter la
première fois de l’année.
Faute de quoi, vous serez souffreteux ou pauvre toute
l’année.
Aussi de nos jours, dit-on encore qu’il convient de
mettre une pièce de monnaie dans sa main ce jour là.
- Les artichauts : Comment imaginer qu’un simple artichaut (le plat du
pauvre, celui avec lequel on en a plus dans son assiette après l’avoir mangé
qu’avant de le commencer…) pourrait vous créer quelques problèmes ?
Pourtant, si ses feuilles sont en nombre impair, vous
aurez gagné une semaine d’ennuis !
Doit-on pour autant se lancer dans un effeuillage en règle ? Non bien sur.
Il suffit simplement de prononcer tout bas la formule magique : « Peu me chaut tes maux,
artichaut ! » (peu m’importe tes maux, artichaut, mais là je vous renvoie
à la conjugaison du verbe « chaloir ») et le tour est joué.
Vous pouvez aussi, avec votre couteau, tracer une «
croix de saint André » sur le fond ou encore le trancher net avant d’en
détacher la première feuille.
- Pendant l’orage : Cette curieuse superstition consistait à faire sortir
tous les animaux de la maison, fermer portes et fenêtres, arroser le sol d’eau
bénite, et se signer à chaque éclair pour se protéger de la foudre.
En revanche le (pauvre) bûcheron qui se trouvait en forêt devait tenir sa cognée fer en haut, le tranchant dirigé vers le ciel de manière à fendre l’éclair s’il venait à tomber… Imparable !
- Le signe : Toujours présent dans toutes les situations, le signe
de croix se devait même d’être exécuté avant que ne soit enfilée une chemise
neuve, voire même seulement propre.
Le Garlutot du loup (conte morvandiau)Cliquez sur l’image pour télécharger au format PDF le conte morvandiau de L'abbé Nouveau, professeur au petit séminaire d'Autun
et
Membre titulaire de la Société éduenne (Document archives de la Société éduennes) Sources documentaires- Wikipédia
- Eugène de Chambure, Glossaire du Morvan
- Joseph Bruley : "Morvan, coeur de France" - Alfred Guillaume : « L’âme du Morvan
» - Diderot, encyclopédie - Archives de la Société Eduenne - Claude Chermain, passeur de mémoire - Georges Hervé, Quelques superstitions du Morvan (1892) - Gallica - Evangile des Quenouilles
- Livresanciens-tarascon-blogspot.fr-lacam 001
- lemorvandiaupat - http://lemorvandiaupat.free.fr
- Tite-Live, Histoire de Rome depuis sa fondation
- Pierre Canavaggio, Le guide des superstitions
- Documentation personnelle |